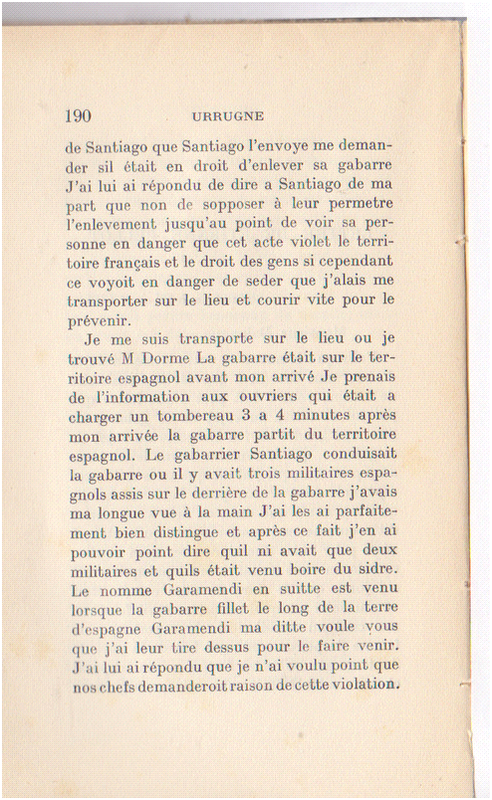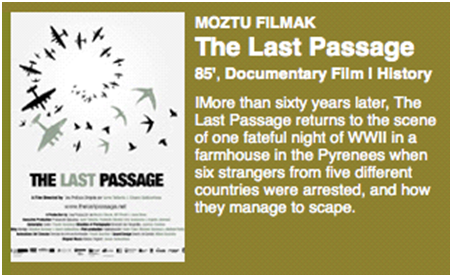LE FAUX MARTIN GUERRE
9
-----------------
LE FAUX MARTIN GUERRE I
Par Gayot de Pitaval
« Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées »
(T.I, page 1, Paris 1735)
C’est probablement l’affaire la plus curieuse
qu’il ait été donné à un tribunal français de juger.
On peut observer sur le vif que les anciens juges,
dont on a beaucoup médit sans tenir compte
des connaissances et des mœurs de leur époque,
cherchaient d’abord scrupuleusement à cerner la vérité,
ensuite à statuer en accord avec le droit et l’équité.
N.B. Afin de faciliter la lecture de ce document,
nous avons ajouté des titres qui ne figurent pas dans l’original,
et remplacé quelques termes obsolètes par des mots contemporains.
Rien n’est plus admirable que cette variété prodigieuse que Dieu a mis dans les visages des hommes, dans l’air qui résulte de l’assemblage des mêmes traits. Un auteur a dit que la Nature, lasse quelquefois de diversifier ses portraits, fait des copies où elle imite parfaitement ceux qu’elle a tracés. C’est ce qu’elle a exécuté dans Arnaud du Tilh, qu’elle fit très semblable à Martin Guerre. Il se prévalut si bien de cette ressemblance, qu’il aurait remplacé pendant sa vie Martin Guerre absent, si celui-ci ne fût revenu, et n’eût dissipé l’illusion. Encore Arnaud du Tilh , après avoir été confronté à Martin Guerre sous les yeux d’un Parlement, balança-t-il quelque temps les lumières des Juges, même après la confrontation.
L’Histoire, qui nous présente plusieurs célèbres imposteurs qui ont abusé de la ressemblance qu’ils avaient avec les personnes dont ils voulaient usurper le nom, les biens et l’état, ne nous en offre point qui ait poussé l’impudence et l’effronterie plus loin que le faux Martin Guerre.
Source de ce document : Rapport du Conseiller Coras
Voici toutes les circonstances de cette histoire merveilleuse, dont Monsieur Coras, rapporteur du procès, a fait part au public : il l’a enrichi de savantes observations. Il serait à souhaiter que les Juges nous fissent l’histoire des procès extraordinaires dont ils ont fait le rapport : ils nous apprendraient, à l’exemple de Monsieur Coras, les véritables motifs des jugements qui ont été rendus.
Quelque curieuses que soient les observations de Monsieur Coras, comme il promène son lecteur dans des recherches qui ne sont pas de son sujet, je ne m’égarerai point avec lui. Je ne le suivrai point dans ces traits d’érudition déplacés, qui étaient alors en usage parmi les savants, et que le bon sens, qui met chaque chose à sa place, retranche à présent de nos ouvrages.
Martin Guerre, avant sa disparition
Martin Guerre, né à HENDAYE dans le Labourd , âgé d’environ onze ans, épousa, au mois de Janvier 1539, Bertrande de Rols de la Ville d’Artigues, au Diocèse de Rieux : ils étaient à peu près de même âge ; elle unissait la sagesse à la beauté, suivant le témoignage de Monsieur Coras, qui dit que dans le temps du procès elle était jeune, sage et belle. Ces deux époux jouissaient d’une fortune honnête : on ne parle point de leur naissance ; mais on juge qu’ils étaient d’une condition un peu au-dessus de celle du simple paysan. Dès que le paysan n’est pas assujetti absolument à gagner sa vie, il prend l’essor au-dessus de son rang ; et c’est ce que la Fontaine appelle un demi-bourgeois, un demi-manant.
Martin Guerre demeura avec sa femme neuf ou dix ans : les huit ou neuf premières années il eut le sort de Tantale : quelque brûlant désir qu’il eût, il ne pouvait posséder sa femme ; il se croyait maléficié, ensorcelé. La crédulité, qui régnait davantage en ce temps là que dans celui-ci, le confirmait dans cette opinion. Il devait plutôt penser que l’âge tendre où il était lui refusait des plaisirs qui lui étaient réservés dans un âge plus avancé. En effet, lorsqu’il approcha de vingt ans, il fut en état de faire usage des appâts de sa femme. Bertrande de Rols, qui se croyait ensorcelée aussi bien que son mari, s’imagina que le charme était rompu ; parce que, suivant le conseil qu’on lui donna, elle fit dire quatre messes, mangea quelques hosties et fouaces. Ainsi on se sert de la crédulité même pour guérir le mal qu’elle a causé.
Un trait de la sagesse de cette femme fut la résistance qu’elle fit à ses parents, qui lui conseillèrent, dans le temps de cette disgrâce, de se séparer en justice d’avec son mari. Elle fit voir que sa tendresse n’avait pas besoin d’être soutenue par les plaisirs des sens. Un fils, appelé Sanxi, fut le fruit de leur mariage dans la dixième année. Martin Guerre, ayant fait à son père un larcin de blé qui n’était pas considérable, s’absenta pour se dérober à sa colère. Il fut tenté de voyager, soit qu’il commençât à se lasser de sa femme, car celles qui sont les plus charmantes ne sont pas plus privilégiées que les autres, et ne mettent pas leurs maris à l’abri du dégoût que la possession traîne ordinairement après elle ; soit que le libertinage eût des attraits pour lui. Quoi qu’il en soit, il fut huit ans sans donner de ses nouvelles à sa femme. C’est alors qu’une femme négligée, pour ne pas dire méprisée par un mari absent, a besoin de toute sa vertu pour ne pas succomber. La médisance n’a pourtant rien publié contre la conduite de Bertrande de Rols, quoique l’absence de son mari ait été de huit années.
Survenance d’un imposteur : Arnaud du Tilh
Arnaud du Tilh, dit Pansette, du lieu de Sagias, se présenta. Comme il avait les mêmes traits, les mêmes linéaments de visage que Martin Guerre, il fut reconnu pour être le véritable mari de Bertrande de Rols par les quatre sœurs du mari, son oncle, et les parents de la femme, et par elle-même. Il avait étudié son rôle parfaitement, et ayant connu Martin Guerre dans ses voyages, il avait appris de lui ce qu’il avait fait de plus particulier avec sa femme, les paroles qu’ils avaient tenues, qu’ils n’avaient confiées dans leur lit qu’aux ténèbres ; les époques de certains événements secrets. Enfin Martin Guerre avait révélé à Arnaud du Tilh des mystères qu’un mari couvre ordinairement du voile du silence. L’imposteur était parfaitement instruit de mille circonstances particulières. On peut dire qu’il savait son Martin Guerre parfaitement mieux encore que Martin Guerre lui-même.
Bertrande de Rols, qui aimait son mari, et qui soupirait ardemment après sa présence, fut d’abord facilement persuadée que le faux Martin Guerre était le véritable. Elle se livra entièrement à l’imposteur, qui pendant plus de trois ans la posséda et en eut deux enfants, l’un desquels mourut peu de temps après sa naissance.
On n’a jamais mieux imité un mari, Jupiter ne joua pas mieux son rôle à l’égard d’Alcmène. Bien des gens croiront que Bertrande de Rols aida à se tromper elle-même, parce que l’erreur lui plaisait ; et ne penseront point qu’une ressemblance soit si exacte qu’elle puisse parfaitement tromper une femme à qui un mari se décèle entièrement. Qu’on ait eu une longue habitude et une grande familiarité avec une personne, non seulement ses traits, son port, sa démarche, sa voix dans ses inflexions, ses gestes ordinaires, s’imprimeront vivement dans notre esprit ; mais un je ne sais quoi dans son air, dans ses façons. On saisit ce qui serait imperceptible à tout autre. Il n’est pas possible qu’un imposteur ait ce je ne sais quoi, ces différences si délicates ; à plus forte raison une femme, à qui rien n’échappe dans un mari, doit-elle être à l’abri de l’imposteur qui veut le représenter. Son imagination la doit vite faire revenir d’une erreur qui l’aura surprise, parce qu’elle comparera l’idée du mari absent avec l’imposteur en original. Mais, comme les absents ont tort auprès de certaines femmes, on voudra peut être croire que cet original eut raison auprès de Bertrande de Rols, étant confronté avec l’idée qui représentait un absent.
Doutes des proches, notamment de Pierre Guerre
Quoi qu’il en soit, Pierre Guerre, oncle de Martin Guerre, et plusieurs autres personnes ayant ouvert les yeux, les ouvrirent à Bertrande de Rols, en lui rappelant les véritables idées de son mari. Elle mit l’imposteur entre les mains de la Justice, l’ayant fait arrêter sur la plainte qu’elle rendit, et sur l’information qui fut faite en conséquence par devant le Juge de Rieux. Elle demanda, dans une requête, qu’il fût condamné à une amende envers le Roi, à demander pardon à Dieu, au Roi, et à elle, tête découverte, et pieds nus et en chemise, tenant une torche ardente en ses mains ; disant que, faussement, témérairement, traîtreusement, il l’a abusée en prenant le nom et supposant la personne de Martin Guerre, dont il se repent, et lui demande pardon ; qu’il soit condamné envers elle à une amende de dix mille livres, aux dépens, dommages et intérêts : voilà quelles furent ses conclusions.
Ceux qui l’ont déjà condamnée diront, qu’étant lasse de l’imposteur, ou plutôt s’étant brouillée avec lui, elle prit la résolution de le perdre, et de s’en délivrer ; que les femmes passent facilement d’une extrémité à l’autre, et que, si l’imposteur avait eu plus d’adresse et de complaisance, il aurait paré son infortune.
Mais comme je ne suis point naturellement malin, j’aime mieux, en conservant la vertu de Bertrande de Rols, lui attribuer une grande facilité, et même plutôt une grande indigence d’esprit. Sur ce principe, je croirai qu’elle a pu être abusée par l’imposteur ; qu’ayant douté ensuite, elle n’a pas eu la force d’éclaircir son doute, et qu’elle a mieux aimé y persévérer que de faire un éclat. Je croirai que la vérité lui envoyait de temps en temps des éclairs, qu’elle retombait après cela dans des ténèbres qu’elle n’avait pas le courage de dissiper. Voilà l’état où elle fut pendant le règne de l’imposteur. Enfin cette même facilité qu’elle a eue à croire le faux Martin Guerre l’a entraînée à croire Pierre Guerre, et à poursuivre l’imposteur. Les gens faciles agissent ordinairement par les impressions d’autrui.
Arnaud du Tilh traduit devant le Juge de Rieux
Arnaud du Tilh allégua d’abord pour sa défense, par devant le Juge de Rieux, que nul malheur n’égalait le sien, puisqu’il avait une femme et des parents qui avaient le cœur si mauvais que de lui contester son état et son nom, pour le dépouiller de son bien, qui pouvoir valoir sept à huit mille livres ; que Pierre Guerre, qui lui intentait ce procès, était guidé par une animosité dont la cupidité était la source ; que les gendres de son oncle épousaient sa passion ; que pour satisfaire à leur avarice ils l’accusaient de prendre le nom de Martin Guerre, et d’en supposer la personne ; qu’ils avaient suborné sa femme, et l’avaient engagée aux dépens de son honneur dans cette accusation calomnieuse, inouïe et horrible dans la bouche d’une femme légitime ; accusation qui était le comble du crime le plus noir, si elle n’était pas l’ouvrage de sa facilité.
Il faisait ensuite son histoire, en racontant la cause de son absence, et rendait compte de la vie qu’il avait menée depuis ; disant qu’il avait servi le Roi à la guerre pendant sept ou huit années ; qu’il avait passé ensuite au service du Roi d’Espagne, où il avait été quelque mois ; qu’enfin brûlant du désir de revoir sa femme, son enfant, ses parents, sa patrie, il était revenu à Artigues ; que malgré le changement que le temps avait fait à son visage, puisqu’étant parti ayant du poil follet au menton, il était revenu ayant de la barbe, il avait eu pourtant la satisfaction d’être reconnu par ce même Pierre Guerre son oncle, qui avait à présent la barbarie de le vouloir méconnaître ; que ce même oncle l’avait comblé alors de caresses, et qu’il n’avait perdu son amitié que parce qu’il lui avait demandé compte de sa gestion et de ses revenus, que celui-ci avait administrés pendant son absence ; que s’il avait voulu lui sacrifier son bien, on ne le ferait pas passer pour un imposteur ; que son oncle n’avait rien oublié pour le perdre, et lui ôter la vie ; qu’après l’avoir épié plusieurs fois, il l’avait attaqué avec avantage, l’avait jeté à terre d’un coup d’une barre de fer, et qu’il l’aurait assommé, si sa femme, n’ayant point d’autre moyen pour le sauver, ne se fût étendue sur lui, et ne lui eût servi de bouclier pour recevoir les coups. Qu’enfin lui et ses gendres avaient cru qu’en ourdissant la trame de cette accusation ils viendraient mieux à leurs fins, parce qu’ils surprendraient la Justice, et tiendraient de sa main les biens dont ils le dépouilleraient.
II demanda que sa femme lui fût confrontée, persuadé qu’elle n’était pas capable d’étouffer entièrement la vérité, n’étant pas aveuglée par la passion qui transportait ses persécuteurs. Il demanda encore que ses calomniateurs fussent condamnés, suivant les lois de l’équité aux mêmes peines qu’ils voulaient lui faire subir ; que Bertrande de Rols fut tenue dans une maison où elle fût à l’abri de la subornation, et de toutes les impressions de Pierre Guerre et de ses gendres, qui ne pourraient pas l’approcher. Enfin il demandait d’être renvoyé absous de l’accusation, avec dépens et dommages-intérêts.
L’instruction devant le Juge de Rieux
Il subit un ample interrogatoire, où il rendit raison de toutes les questions que le Juge lui fit sur la Biscaye, sur le lieu de la naissance de Martin Guerre, le père, la mère, les frères, les sœurs et les autres parents du même ; sur l’année, le mois, le jour de ses noces, son beau-père, sa belle mère, les personnes qui y étaient, celles qui traitèrent le mariage, les différents habits des conviés, le prêtre qui célébra le mariage, les circonstances les plus particulières qui arrivèrent le jour de la noce et le lendemain, jusqu’à nommer les personnes qui l’allèrent voir à minuit le jour de la noce dans son lit nuptial. Il parla de Sanxi son fils, du jour qu’il naquit ; il parla de son départ, des personnes qu’il rencontra sur son chemin, des propos qu’il leur tint, des villes qu’il avait parcourues en France et en Espagne, des personnes qu’il avait vues dans ces deux royaumes, et afin qu’on pût être éclairci parfaitement de ce qu’il disait, il citait des personnes qui pouvaient confirmer ce qu’il déposait.
On fut convaincu, par les éclaircissements qu’on prit, qu’il n’avait rien avancé qui pût servir à le confondre. On ne pouvait pas mieux retracer tout ce qu’avait fait Martin Guerre. Mercure ne rappela pas mieux à Sosie toutes ses actions, que le faux Martin Guerre rappela celles du véritable.
On ordonna que Bertrande de Rols, et certaines personnes que l’accusé avait citées dans son interrogatoire seraient interrogées. Bertrande de Rols dans ses réponses rapporta tous les faits qu’avait déposé l’accusé avec une parfaite conformité ; excepté qu’elle dit l’histoire du charme qui liait la puissance de son mari, et qu’elle raconta comment au bout de huit ou neuf ans le charme fut rompu. Elle ajouta qu’elle ne voulut point se rendre aux sentiments de ses parents, qui lui conseillèrent d’obtenir une séparation de corps d’avec son mari : elle n’avait garde d’oublier ce trait héroïque de sa vertu. Elle dit que Sanxi son fils, qu’elle conçut, fut la preuve évidente qu’il n’y eut plus de fascination. Ainsi la magie blanche de l’Amour l’emporta sur la magie noire du Démon.
L’accusé ayant été interrogé sur cet ensorcellement, répondit sur le maléfice, sur les cérémonies qu’on avait pratiquées pour le rompre, comme s’il eût ajusté ses réponses à celles de Bertrande de Rols. On le confronta à cette femme, et à tous les témoins ; il requit de nouveau qu’elle fût isolée, afin que ses ennemis n’abusassent pas de sa facilité : on lui accorda ce qu’il demandait.
Il fournit des reproches contre les témoins qui déposèrent contre lui : il demanda qu’il lui fût permis de publier un monitoire pour avoir révélation de la subornation de Bertrande de Rols, et pour vérifier les reproches qu’il opposait aux témoins. II obtint encore cette demande : mais on ordonna en même temps qu’on ferait une enquête d’office sur les lieux au Pin, à Sagias, et à Artigues, de tous les faits qui pouvaient concerner Martin Guerre, l’accusé, et Bertrande de Rols, et l’honneur et la réputation des témoins confrontés. Les révélations du monitoire, et les dépositions des enquêtes constatèrent la vertu de Bertrande de Rols, qui ne s’était point démentie pendant l’absence de son mari.
À l’égard de 1’accusé, de cent cinquante témoins environ qui furent ouïs, trente à quarante déposèrent qu’il était véritablement Martin Guerre, pour avoir eu de grandes habitudes avec lui dès son enfance ; et ils le reconnurent à certaines marques et cicatrices que le temps n’avait point effacées.
D’autres témoins, en plus grand nombre, déclarèrent que l’accusé était Arnaud du Tilh, dit Pansette, pour l’avoir vu et fréquenté dès le berceau. Le reste des témoins, jusqu’au nombre de soixante et davantage, dirent qu’il y avait une ressemblance si frappante entre l’un et l’autre, qu’ils n’osaient pas assurer si l’accusé était Martin Guerre, ou Arnaud du Tilh.
On ordonna deux rapports de la ressemblance, ou dissemblance, de Sanxi Guerre avec l’accusé, et avec les sœurs de Martin Guerre. Il résulte du premier rapport que Sanxi Guerre ne ressemble point à l’accusé, et il résulte du second qu’il ressemble aux sœurs de Martin Guerre.
Arnaud du Tilh condamné par le Juge de Rieux
Enfin, par la sentence définitive du premier Juge, Arnaud du Tilh est déclaré atteint et convaincu d’être un imposteur, et condamné à perdre la tête ; et on ordonna que son corps après sa mort serait mis en quatre quartiers.
Voilà tout ce que M. Coras nous apprend de la sentence. Le premier Juge condamna l’accusé, comme s’il eût été inspiré ; car après ce qu’on vient de rapporter, à ne suivre que les lumières humaines, son jugement était téméraire. On est obligé de convenir que l’information, les révélations du monitoire et l’enquête laissaient du moins la vérité dans le doute. Or dans le doute un premier juge ne s’expose-t-il pas à être blâmé quand il franchit le pas, et condamne hardiment un accusé dont l’innocence se présente à l’esprit aussitôt que le crime ? Comptait-il pour rien la faveur du mariage et des enfants ? N’était-ce pas le cas d’ordonner du moins un plus amplement informé ?
Appel d’Arnaud du Tilh devant le Parlement de Toulouse
Arnaud du Tilh s’étant rendu appelant au Parlement de Toulouse, cette Cour crut qu’il fallait peser cette affaire plus mûrement que ne l’avait fait le premier juge. Elle ordonna d’abord que Pierre Guerre et Bertrande de Rols seraient confrontés en pleine Chambre l’un après l’autre à l’accusé.
Dans ces deux confrontations il eut une contenance si assurée, et un front si ouvert, que les juges crurent y lire qu’il était le véritable Martin Guerre, tandis qu’ils lisaient sur le front de Pierre Guerre et de Bertrande de Rols déconcertés, qu’ils étaient des calomniateurs. Mais, comme ces confrontations ne pouvaient pas être de parfaits tableaux de la vérité, on ordonna qu’on ferait d’office une enquête sur plusieurs faits importants, dans laquelle on entendrait d’autres témoins que ceux qui avaient déjà été ouïs.
Cette nouvelle enquête, au lieu de conduire à la lumière de la vérité dans l’esprit des juges, n’y apporta que l’obscurité du doute et de l’incertitude. De trente témoins qui furent ouïs de nouveau, neuf ou dix déclaraient que c’était le véritable Martin Guerre ; sept ou huit, que c’était Arnaud du Tilh ; le reste, balançant toutes les circonstances et tous les caractères de la ressemblance, disaient qu’ils ne pouvaient rien assurer de certain et de positif.
Tout cela, dit Monsieur Coras, jetait les juges dans une grande perplexité. Ils pensaient autrement que le premier juge, et ils ne se laissaient pas guider par des lueurs.
L’instruction devant le Parlement de Toulouse
En rassemblant toutes les dépositions, on trouvait que quarante-cinq témoins assuraient que l’accusé n’était point Martin Guerre, mais Arnaud du Tilh ; et ils apportaient des raisons pertinentes de leurs créances, en disant qu’ils avaient fréquenté l’un et l’autre, et qu’ils les avaient connus parfaitement, ayant bu et mangé avec eux depuis leur enfance. Parmi ces témoins, il en faut distinguer dont la qualité donne un grand poids à leurs témoignages.
Le premier témoin est un oncle maternel d’Arnaud du Tilh, appelé Carbon Bareau, qui le reconnut pour son neveu, et lui voyant les fers aux pieds pleura amèrement, en déplorant la triste destinée d’une personne qui lui appartenait de si près. On ne peut pas soupçonner qu’un si proche parent, dont le sang parle en faveur de l’accusé, ait voulu trahir la vérité. C’est à la force de cette même vérité qu’il faut attribuer ce témoignage qui condamnait son neveu : témoignage si contraire aux sentiments de la nature. Il y a d’autres témoins qui ont contracté avec Arnaud du Tilh ou qui ont été présents aux actes qu’il avait passés et les avaient signés ; et ils produisent ces actes.
Presque tous ces témoins disent que Martin Guerre était plus haut et plus noir ; qu’il était grêle de corps et des jambes, un peu voûté, portant la tête entre deux épaules, le menton fourchu et élevé dans le sommet ; que sa lèvre de dessus était pendante, qu’il avait le nez large et camus, la marque d’un ulcère au visage, une cicatrice au sourcil droit. Or Arnaud du Tilh était petit, trapu, fourni de corps, ayant la jambe grosse : il n’était ni camus ni voûté ; il avait pourtant au visage les mêmes marques que Martin Guerre.
Le cordonnier qui chaussait Martin Guerre déposa qu’il le chaussait à douze points, et que l’accusé ne se chaussait qu’à neuf. Un autre Témoin dépose que Martin Guerre était habile dans le jeu des armes et à la lutte : l’accusé n’y entendait rien. Jean Espagnol, hôte du lieu de Touges, a déposé que l’accusé se découvrit à lui, et lui dit de ne le pas déceler ; que Martin Guerre lui avait donné tout son bien. Valentin Rougie a aussi déposé que l’accusé, voyant que ce témoin le connaissait pour Arnaud du Tilh, lui fit signe du doigt de ne rien dire. Pelegrin de Liberos a fait la même déposition, et dit que l’accusé lui avait donné deux mouchoirs, à la charge d’en donner un à Jean du Tilh son frère.
Monsieur Coras observe que la Loi qui ne veut pas qu’on ajoute foi à un témoin qui parle par ouï-dire ne comprend pas ceux qui disent avoir ouï-dire aux accusés. Une histoire qui passe par différentes bouches est sujette à être altérée : on la brode, et on l’embellit ; mais le témoin qui l’a puisée dans sa source n’est pas sujet à ces inconvénients.
Deux autres témoins ont déposé qu’un soldat de Rochefort passant par Artigues fut surpris que l’accusé se dît Martin Guerre : il dit tout haut qu’il était un imposteur, que Martin Guerre était en Flandres ; qu’il avait une jambe de bois à la place de celle qui lui avait été emportée d’un coup de boulet devant Saint-Quentin, à la bataille de Saint Laurent.
On employait contre l’accusé le rapport dont on a parlé, qui constate que Sanxi Guerre n’a aucune ressemblance avec lui.
On ajoutait que Martin Guerre était de Biscaye, où le langage Basque qu’on y parle est bien différent du Français et du Gascon. L’accusé ignore le Basque, et n’en sait tout au plus que quelques mots qu’il place de temps en temps par affectation dans son discours.
Plusieurs témoins ont déposé qu’Arnaud du Tilh dès son enfance a eu les plus mauvaises inclinations ; qu’il a depuis été consommé dans le crime, que le larcin lui était familier. C’était un jureur, un renieur de Dieu et un blasphémateur. D’où il s’en suivait qu’il était bien capable de jouer le rôle d’un imposteur, et que l’impudence qu’il témoignait était dans son caractère.
Voilà les sortes de raisons qui découvraient l’imposture. Mais elles étaient obscurcies par les raisons suivantes.
Trente ou quarante témoins affirmaient qu’il était Martin Guerre, et appuyaient leur témoignage, en disant qu’ils avaient eu des liaisons avec lui dès son bas âge ; qu’ils avaient souvent bu et mangé ensemble.
Parmi ces témoins, il fallait considérer les quatre sœurs de Martin Guerre, qui avaient été élevées avec lui, dont la sagesse était dans une très bonne odeur. Elles ont toujours assuré constamment que l’accusé était Martin Guerre leur frère ; les deux beaux-frères de Martin Guerre, mariés chacun à une de ses soeurs, rendaient le même témoignage. Pouvait-on penser que quatre sœurs élevées avec Martin Guerre se trompassent ensemble. Si l’imposteur avait quelque différence, même la moins remarquable, ne l’auraient elles pas saisie ?
Des témoins qui ont assisté aux noces de Martin Guerre et de Bertrande de Rols ont déposé en faveur de 1’accusé. Catherine Boere a dit que sur le minuit elle apporta aux nouveaux mariés la collation qu’on appelle Media noche, ou le réveillon, et que 1’accusé était bien l’époux qu’elle trouva couché avec Bertrande de Rols. La plus grande partie des témoins qui parlèrent en faveur de l’accusé apportent, pour preuve de leurs témoignages, que Martin Guerre avait deux soubredents à la mâchoire de dessus, une goutte de sang extravasé à l’oeil gauche, l’ongle du premier doigt enfoncé, trois verrues à la main droite, une autre au petit doigt : toutes ces marques l’accusé les avait. Par quel jeu la Nature, qui les avait données à Martin Guerre, les aurait-elle imitées si précisément dans une autre personne ?
D’autres témoins ont déposé qu’il y avait partie liée entre Pierre Guerre et ses gendres pour perdre l’accusé ; qu’ils avaient sondé Jean Loze, Consul de Palhos, pour savoir s’il voudrait leur fournir de l’argent pour conduite cette trame à sa fin ; qu’il les avait refusés, en leur disant que Martin Guerre était son parent ; qu’il donnerait plutôt de l’argent pour le sauver que pour le perdre. Ils ajoutent que le bruit commun à Artigues est que Pierre Guerre et sa cabale poursuivent l’accusé contre la volonté de sa femme, et que plusieurs personnes ont souvent ouï dire à Pierre Guerre que l’accusé était Martin Guerre son neveu.
Presque tous les témoins qui ont été ouïs assurent que lorsque l’accusé arriva à Artigues il saluait, et appelait de leurs noms, tous ceux qui étaient de la connaissance et de l’intime familiarité de Martin Guerre ; qu’il rappelait à ceux qui avaient peine à le reconnaître la mémoire des lieux où ils avaient été, des parties de plaisir qu’ils avaient faites, des conversations qu’ils avaient eues depuis dix ans, quinze ans, vingt ans ; comme si toutes ces choses avaient été faites fraîchement : et ce qui est de plus remarquable, c’est qu’il se fit connaître à Bertrande de Rols en lui retraçant des mystères du lit nuptial, et les circonstances des événements les plus secrets ; il lui dit même, après les premières caresses qu’il lui fit, va me chercher ma culotte blanche, doublée de taffetas blanc, que j’ai laissée dans un coffre. Bertrande de Rols est convenue de ce fait, et elle a dit qu’elle trouva la culotte dans le lieu indiqué, où elle ne la savait pas.
Pasquier dit que l’accusé s’attribua une aventure que Martin Guerre avait eue dans une campagne où il était allé avec sa femme. Il n’y avait que deux lits pour Martin Guerre et sa femme, un frère et une sœur, les deux femmes couchèrent ensemble, et les deux hommes dans l’autre lit ; Martin Guerre, pendant le sommeil de son camarade de couche, conduit par l’amour conjugal qui s’irrite des obstacles ainsi qu’un autre amour, alla fort doucement chercher sa femme qu’il trouva éveillée ; il revint à son lit avant le jour : dès cette nuit-là il était devenu père. L’accusé nomma le prêtre qui avait baptisé l’enfant, le parrain et la marraine.
De là il s’ensuit que Martin Guerre seul pouvait avoir ces idées, et qu’il n’y avait que son cerveau qui put être rempli de toutes ces traces ; qu’un autre ne pouvait pas les rassembler en si grand nombre. Qu’on suppose un imposteur, qui n’a connu aucune personne dans un lieu où il voudra représenter un homme qui y aura demeuré ; qui y aura eu une infinité de liaisons, où il aura joué pendant l’espace de plusieurs années bien des scènes, qui se sera communiqué à des parents, des amis, des gens indifférents, des gens de toute espèce ; qui aura une femme, c’est-à-dire une personne sous les yeux de laquelle il est plus des deux tiers de la vie, une personne qui l’étudie continuellement, avec qui il multiplie les conversations à l’infini sur tous les tons imaginables. Comment cet imposteur pourra-t-il tenir son rôle devant tous ces gens-là, sans que sa mémoire soit jamais en défaut ?
Disons plutôt, comment aura-t-il pu mettre dans sa mémoire tant d’espèces ? En supposant qu’il les y ait pu mettre, comment se réveilleront-elles quand il le faudra à point nommé ? Et pour les y pouvoir mettre, combien de conversations a-t-il dû avoir avec celui dont il veut jouer le rôle ? Celui-ci peut-il jamais lui tout dire, lui tout développer ? Il faut donc supposer, pour que le véritable Martin Guerre ait eu cette complaisance, qu’il s’est accordé avec le faux, dont il a voulu être supplanté. De l’impossibilité morale, et même physique à un imposteur de si bien jouer son rôle, il s’ensuit que l’accusé est le véritable Martin Guerre.
Il faut encore observer qu’il résulte du rapport de la ressemblance entre l’accusé et les sœurs de Martin Guerre, qu’il ne peut pas y en avoir une plus parfaite entre leurs airs et leurs traits de visage. Ceux qui ont fait le rapport disent que deux œufs ne sont pas plus semblables.
La conduite de Bertrande de Rols, femme de Martin Guerre
Ce qui ne doit pas laisser le moindre doute, et mettre dans tout son jour la fraude et la calomnie qui ont été machinées contre l’Accusé, c’est la conduite que Bertrande de Rols a tenue avec lui dans ce procès. Quand elle lui fut confrontée, l’accusé l’interpella par la religion du serment de le reconnaître, il la fit juge de sa cause, il lui dit qu’il se soumettait à une peine capitale, si elle jurait qu’il ne fût pas Martin Guerre : l’imposture se serait-elle soumise à une pareille épreuve ? Il n’y avait que l’assurance que donne la vérité qui pût obliger l’accusé à se livrer ainsi à celle qui le poursuivait. Que répondit-elle ? qu’elle ne voulait ni jurer, ni le croire. N’était-ce pas comme si elle disait, quoique je ne puisse pas trahir la vérité qui me condamne et qui parle pour vous, je ne veux pourtant point la reconnaître dans le temps même qu’elle m’échappe malgré moi ; parce que j’ai fait trop de progrès pour retourner en arrière.
Voyons la conduite qu’elle a tenue avec l’accusé avant le procès. Elle a vécu trois ou quatre ans avec lui sans se plaindre : elle s’est livrée à lui comme une femme à son mari, et a vécu tout ce temps là avec lui sous les douces lois du mariage. Est-ce que l’accusé a un rapport si parfait avec Martin Guerre, qu’il n’y ait pas la moindre différence que sa femme ait pu apercevoir ? La nature s’est-elle tellement attachée à les faire ressembler, qu’elle ait voulu que la femme de Martin Guerre ne pût reconnaître l’erreur ? Dans un corps si semblable a-t-elle voulu loger une âme du même caractère ? Car Bertrande de Rols ne cite là-dessus aucune différence. Quand quelqu’un lui disait que l’accusé n’était pas Martin Guerre, ne le démentait-elle pas en prenant un ton aigre et choquant ? Ne lui a-t-on pas ouï dire qu’elle le reconnaissait mieux que personne, et qu’elle ferait mourir ceux qui diraient le contraire ? Et pour faire voir qu’il n’était pas possible que l’accusé ne fût Martin Guerre, ne disait-elle pas que c’était lui, ou un Diable en sa peau ?
Combien de fois s’est-elle plainte de Pierre Guerre et de sa femme, qui est sa mère, parce qu’ils voulaient l’obliger à poursuivre l’accusé comme un imposteur ? Ils la menaçaient même de la chasser de sa maison, si elle ne prenait ce parti. Il est évident qu’elle est à présent séduite et esclave de la passion de Pierre Guerre et de sa mère.
On rapporte que l’accusé ayant été constitué prisonnier pour une autre affaire, de l’autorité du Sénéchal de Toulouse, à la requête de Jean d’Escornebeuf le cadet, et Pierre Guerre étant sa secrète partie adverse, on lui soutint qu’il n’était pas Martin Guerre. Bertrande de Rols se plaignit de ce que Pierre Guerre et sa femme la sollicitait continuellement de faire un procès à l’accusé sur son nom et sur son état, afin de le faire condamner à une peine capitale.
Quand il fut élargi en vertu du jugement du Sénéchal qui prononça entre les parties un appointement de contrariété, Bertrande de Rols le reçut avec des démonstrations de joie, le caressa, lui donna une chemise blanche, s’abaissa jusqu’à lui laver les pieds. Après qu’elle lui eut rendu ce service, il usa de tous les privilèges de mari. Cependant dès le lendemain Pierre Guerre, comme procureur de Bertrande de Rols, accompagné de ses gendres, eut l’inhumanité de le faire conduire en prison. Il est certain que la procuration qu’il alléguait ne fut passée que fort tard sur le soir. Qui ne voit que Bertrande de Rols n’eut pas la force de résister à l’ascendant tyrannique que Pierre Guerre avait pris sur elle ? Ce qui confirme cette vérité, c’est qu’elle envoya à l’accusé, prisonnier, de l’argent pour sa nourriture et un habit.
Il s’ensuit évidemment que, puisque Bertrande de Rols l’a connu pendant un long temps pour son mari, et qu’à présent on fait violence à ses sentiments et à ses lumières, il est incontestablement Martin Guerre. Si un ancien a dit qu’il n’appartenait qu’à un mari de bien connaître sa femme, par la même raison on peut dire qu’il n’appartient qu’à une femme de bien connaître son mari.
Bilan de la seconde instruction
Après tant de raisons convaincantes, la Cour n’était elle pas obligée de reconnaître l’accusé pour Martin Guerre, puisque dans le doute même elle devait prendre ce parti qui favorisait le mariage, et l’état de l’enfant qui en était issu ? Suivant la loi civile et les interprètes, quand bien même on ne considérerait que l’accusé, on se déterminerait toujours à ce jugement ; parce qu’il vaut mieux dans le doute s’exposer à laisser un coupable impuni qu’à perdre un innocent.
Il ne sert de rien d’alléguer que si l’accusé a plusieurs témoins qui déposent en sa faveur, il y en a encore un plus grand nombre qui déposent contre lui ; parce que les dépositions de ceux qui se déclarent pour lui doivent prévaloir, étant plus vraisemblables, et étant en outre en faveur du mariage et de l’état des enfants. C’est une règle constante, qu’on ajoute plus de foi à deux témoins qui affirment qu’à mille témoins qui nient. Aristote, dans son troisième livre de métaphysique, en rapporte la raison : celui, dit-il, qui affirme a une raison de créance plus certaine que celui qui nie. II faut ajouter que ce qui fait prévaloir une affirmation, c’est qu’elle est précise et circonstanciée ; au lieu qu’une dénégation est vague et indéfinie.
A l’égard du témoignage de Carbon Barreau et des autres, qui ont rapporté des faits particuliers et spécieux, ils ont été valablement reprochés, et les objets bien prouvés. Le langage du soldat qu’on rapporte n’est d’aucune considération, puisqu’il n’a point été ouï : ce n’est donc qu’un ouï dire qui ne fait aucun foi en justice.
Quant aux signalements de Martin Guerre qu’on oppose, ils se trouvent dans l’accusé, si on excepte sa grosseur qu’on dénie à Martin Guerre, et la hauteur de la taille qu’on attribue à celui-ci. Il n’est pas étrange que Martin Guerre, qui était grêle et menu, si l’on veut, étant extrêmement jeune, après une si longue absence paraisse plus gros et plus fourni. Combien d’exemples pareils pourrait-on citer ? Un homme qui devient gros semble aux yeux être devenu plus petit. La dissemblance de Sanxi Guerre avec l’accusé ne prouve rien. Combien de fils qui n’ont aucun rapport avec leur père ? Sa ressemblance avec ses sœurs est d’un plus grand poids, puisque c’est une ressemblance de personnes à peu près de même âge, parvenus dans un état où la nature ne fait plus de changement.
On ne doit faire aucun fonds sur ce qu’on allègue, que l’accusé ne parle point le Basque, qui est le langage du lieu de sa naissance. N’apprend-on pas, par les enquêtes qui ont été faites, que Martin Guerre est sorti de son pays à l’âge de deux ans, ou environ ?
Le caractère de libertin et de débauché qu’on donne à Arnaud du Tilh n’est pas un argument contre l’accusé, puisqu’on démontre qu’il est Martin Guerre. On ne l’a point accusé de débauche, ni de libertinage, dans les trois ou quatre années qu’il a vécu avec Bertrande de Rols. Ces plaidoyers pour et contre sont ceux que fit Monsieur Coras pour éclaircir la vérité, lorsqu’il rapporta le procès, si on excepte le style, et la manière de rendre les moyens. Voici ce qu’il répliqua contre l’accusé.
Les témoins qui déposent contre lui nient en affirmant ; puisqu’en disant qu’il n’est pas Martin Guerre, ils affirment qu’il est Arnaud du Tilh. Ainsi la règle n’a ici aucune application. D’ailleurs une dénégation qui est restreinte par les circonstances du temps, du lieu et des personnes, cesse d’être vague, et elle a autant de force qu’une affirmation.
A l’égard des marques et cicatrices qu’on voit dans l’accusé, et qu’on a reconnues dans Martin Guerre, ce fait n’est point prouvé par plusieurs témoins qui s’accordent ; mais chaque marque a un témoin singulier qui assure l’avoir vue dans Martin Guerre. C’est une règle, que mille témoins singuliers ne font aucune preuve ; on excepte l’usure, la concussion. Quant aux soubredents et aux traits et linéaments du visage, qu’on dit être les mêmes dans Martin Guerre que dans l’accusé, combien l’histoire cite-t-elle de ces sortes de ressemblances ? Sura, étant proconsul en Sicile, y rencontra un pauvre pêcheur qui avait précisément les mêmes traits de visage, et la même taille en grosseur et grandeur que lui ; les mêmes gestes que Sura avait accoutumé de faire étaient familiers à ce pêcheur ; il avait la même contenance, et ouvrait comme lui d’une façon particulière la bouche en riant et en parlant. Ils étaient tous deux bègues : ce qui donna lieu à Sura de dire qu’il était surpris d’une si parfaite ressemblance, puisque son père n’avait jamais été en Sicile. « Que votre surprise cesse, lui dit le pêcheur, ma mère a été plusieurs fois à Rome ». Pline rapporte ce fait (livre VII, chap. XXIII) ; et Valère, cuisinier du grand Pompée, ne lui ressemblait-il pas parfaitement ? Combien d’autres exemples ne pourrait-on pas alléguer ? Si la ressemblance était un argument invincible, tant de célèbres imposteurs, qui ont voulu s’en prévaloir, n’auraient jamais été confondus.
On ne doit point se laisser imposer par tous les traits qu’a rapportés l’accusé dans ses conversations. Il a, dit-on, dans le cerveau précisément les mêmes traces que doit avoir Martin Guerre, il connaît les mêmes personnes, il rappelle exactement les époques, les circonstances des événements qu’a eus celui qu’il représente. C’est un habile comédien, qui n’est monté sur le théâtre pour y jouer son rôle qu’après l’avoir bien étudié : c’est un fourbe ingénieux qui a bien ourdi sa trame, qui a eu l’art d’habiller le mensonge des vêtements de la vérité, et qui couvre du voile de l’impudence les méprises qu’il fait, et empêche par là qu’elles ne fassent leur impression. Monsieur Coras allègue qu’Arnaud du Tilh était soupçonné de magie, et il insinue que par cette voie il avait acquis les connaissances qu’il faisait valoir. Cette raison, qui pouvait faire quelque effet dans ce temps là, n’en ferait point à présent.
L’accusé ne doit tirer aucun avantage du refus que Bertrande de Rols a fait de jurer qu’il n’était pas Martin Guerre. Un serment en matière criminelle n’étant pas une preuve, le refus n’en doit pas faire une contraire. Il y a d’ailleurs des personnes timides, superstitieuses, qui, effrayées par les impressions que leur inspire le serment, ne veulent pas même jurer pour la vérité.
Il ne faut point s’arrêter à l’erreur où a été Bertrande de Rols pendant plus de trois ans, et à la répugnance qu’elle a pu avoir de poursuivre l’imposteur, et aux démarches qu’elle a faites qui ont démenti son accusation. Cette conduite est le tableau d’une personne timide, incapable de prendre une résolution violente, et qui étant d’un caractère plein de bonté ne saurait se déterminer à tramer la perte de quelqu’un, particulièrement d’une personne avec qui elle n’a rien eu de réservé, et qu’elle a regardée comme un autre elle-même. Quand on est de ce naturel bon et craintif, on souffre si l’on est poussé à poursuivre une vengeance qui a pour objet une peine capitale, on a le cœur déchiré ; on se repent de s’être engagé si avant, on tâche de retourner en arrière, et si l’on revient sur ses pas on recule encore. Tel est l’état de Bertrande de Rols, qui a plus d’humanité pour un imposteur que d’indignation contre lui.
Tels étaient les moyens de l’accusé et des accusateurs, et telles étaient leurs réponses et leurs répliques, mises en oeuvre par Monsieur Coras. Dans ce conflit de raisons qui révélaient et obscurcissaient la vérité, et n’en laissaient voir que des éclairs auxquels les ténèbres succédaient, la cause de l’accusé allait prévaloir, en faveur du mariage et de l’état de l’enfant.
Le retour de Martin Guerre
Mais voici le véritable Martin Guerre qui se présente, comme s’il fût descendu du Ciel dans une machine. Monsieur Coras dit que son retour fut un miracle de la Providence, qui ne voulut pas permettre le triomphe de l’imposteur. Il vient, dit-il, d’Espagne, il a une jambe de bois, comme l’avait raconté un soldat, suivant la déposition d’un témoin. Il présente sa requête à la Cour, il fait l’histoire de l’imposteur, il demande à être interrogé. La Cour ordonne qu’il sera arrêté, qu’il subira l’interrogatoire, et qu’il sera confronté à l’accusé, à Bertrande de Rols, à ses sœurs et aux principaux témoins qui ont affirmé opiniâtrement que l’accusé était Martin Guerre.
Il est interrogé sur les mêmes faits qu’on avait demandés à l’accusé : il donne les marques, les enseignes auxquelles on peut le reconnaître ; mais les indices qu’il administre ne sont pas si certains, ni en si grand nombre que ceux que l’accusé à fournis. On les confronte ensemble ; Arnaud du Tilh, qui a armé son front de l’effronterie même, traite Martin Guerre d’imposteur, de maraud, d’homme aposté par Pierre Guerre ; et déclare en élevant sa voix qu’il consent à être pendu, s’il ne prouve pas la fourberie et la machination, et ne couvre pas de confusion ses ennemis. Et sur le ton sur lequel il a commencé, il interroge Martin Guerre sur plusieurs faits passés dans sa maison qu’il devait savoir. Martin Guerre ne répond point avec la même fermeté et la même assurance qu’avait répondu Arnaud du Tilh. De sorte qu’on pouvait dire que le tableau que présentait l’imposteur était plus ressemblant à la vérité, que celui qu’en offrait la vérité elle-même.
Les commissaires, ayant fait retirer Arnaud du Tilh, interrogèrent Martin Guerre sur plusieurs faits secrets et particuliers qu’il devait savoir, et sur lesquels ni l’un ni l’autre n’avaient pas été encore interrogés. On vérifia que Martin Guerre avait répondu juste. On interrogea ensuite en particulier Arnaud du Tilh : il répondit sur dix ou douze demandes qu’on lui fit avec la même justesse ; ce qui le fit soupçonner de magie, dit Monsieur Coras, suivant l’opinion qu’on en avait à Artigues et dans les lieux circonvoisins.
La Cour, pour s’éclaircir parfaitement de la vérité, et dissiper jusqu’au moindre nuage, ordonna que les quatre sœurs de Martin Guerre, chaque mari de chacune des deux sœurs, Pierre Guerre, les frères d’Arnaud du Tilh, et les principaux témoins qui s’étaient obstinés à le reconnaître pour Martin Guerre, comparaîtraient pour choisir entre les deux le véritable. Tous se présentèrent, excepté les frères d’Arnaud du Tilh, que les injonctions de la Cour et les peines dont ils furent menacés ne furent point obliger de venir. La Cour jugea qu’il y aurait de l’inhumanité à les contraindre à déposer contre leur frère ; leur refus de comparaître déposait d’ailleurs contre lui.
La sœur aînée vint la première, et après s’être arrêtée un instant à considérer Martin Guerre, elle le reconnut et l’embrassa en pleurant ; et s’adressant aux Commissaires : voici, leur dit-elle, mon frère Martin Guerre : j’avoue l’erreur où ce traître abominable, poursuivit-elle en montrant Arnaud du Tilh, m’a jetée et entretenue pendant si longtemps, aussi bien que tous les habitants d’Artigues. Martin Guerre mêla ses larmes avec celles de sa sœur en recevant ses embrassements.
Les autres le reconnurent de même, aussi bien que les témoins qui avaient été les plus obstinés à reconnaître Arnaud du Tilh pour Martin Guerre.
Après toutes ces reconnaissances, on appela Bertrande de Rols, qui n’eut pas plutôt jeté les yeux sur Martin Guerre, que toute éplorée et fondant en larmes, tremblante comme une feuille agitée par le vent, pour me servir de la comparaison de Monsieur Coras, elle accourut l’embrasser, lui demandant pardon de la faute qu’elle avait faite en se laissant séduire et abuser par les artifices et les impostures d’un misérable. Elle fit alors pour se justifier un petit plaidoyer que la nature ennemie de l’art lui suggéra. Elle dit qu’elle avoir été entraînée par ses belles-sœurs trop crédules, qui avaient reconnu que l’imposteur était son mari ; que la grande passion qu’elle avait de le revoir aida à la tromper ; qu’elle avait été confirmée dans son erreur par les indice que ce traître lui avait donnés, et par des récits de faits si particuliers qu’ils ne pouvaient être connus que de son véritable mari ; que dès qu’elle avait ouvert les yeux, elle avait souhaité que l’horreur de la mort cachât l’horreur de sa faute, et que, si la crainte de Dieu ne l’eût retenue, elle n’aurait pas hésité à se tuer elle-même ; que ne pouvant soutenir l’affreuse idée d’avoir perdu son honneur et la réputation d’être chaste, elle avait eu recours à la vengeance, et avait mis l’imposteur entre les mains de la Justice, et l’avait poursuivi si vivement qu’elle l’avait fait condamner par le premier Juge à perdre la tête, et son corps après sa mort à être mis en quatre quartiers ; que son ardeur à le poursuivre n’avait point été ralentie, après qu’il eut interjeté appel de la sentence. L’air touchant dont parlait Bertrande de Rols, ses larmes et sa beauté étaient bien plus éloquents que son plaidoyer : l’expression de sa douleur, répandue sur son visage consterné, plaida merveilleusement pour elle.
Le seul Martin Guerre, qui avait été si sensible aux témoignages d’amitié de ses sœurs, parut insensible à ceux de sa femme ; et après l’avoir écoutée sans l’interrompre, il la regarda d’un air farouche, et, prenant un maintien sévère, il lui dit d’un ton méprisant : cessez de pleurer, je ne puis et ne dois point me laisser émouvoir par vos larmes : c’est en vain que vous cherchez à vous excuser par l’exemple de mes sœurs et de mon oncle. Une femme a plus de discernement pour connaître un mari, qu’un père, une mère et tous ses parents les plus proches ; et elle ne se trompe que parce qu’elle aime son erreur. Vous êtes la seule cause du désastre de ma maison ; je ne l’imputerai jamais qu’à vous.
Les Commissaires alors s’efforcèrent de persuader Martin Guerre de l’innocence de Bertrande de Rols, confondue par les foudroyantes paroles de son mari ; mais ils ne purent amollir son cœur, ni fléchir sa sévérité ; le temps seul lui fit changer de sentiment.
Monsieur Coras ne dit point quelle contenance tint Arnaud du Tilh, présent à toutes ces reconnaissances. Il y a apparence qu’il ne se déconcerta point : s’il se fût troublé, Monsieur Coras n’aurait pas oublié cette circonstance. Arnaud du Tilh était un de ces scélérats déterminés, qui bravent la foudre dans le temps qu’elle les écrase. Mais les grands motifs de la Religion l’ébranlèrent, lorsqu’il fut à la veille de subir le dernier supplice. L’imposture n’eut plus aucun retranchement où elle pût se réfugier, et fût entièrement démasquée ; et la vérité se leva sur l’horizon de la Justice avec un grand éclat.
La condamnation d’Arnaud du Tilh
La Cour, après une mûre délibération, prononça l’Arrêt qui suit.
Vu le procès fait par le Juge de Rieux à Arnaud du Tilh, dit Pansette, soi disant Martin Guerre, prisonnier à la Conciergerie, appelant dudit Juge, etc.
Dit a été que la Cour a mis et met l’appellation dudit du Tilh, et ce dont a été appelé, au néant ;
Et pour punition et réparation de l’imposture, fausseté, supposition de nom et de personne, adultère, rapt, sacrilège, plagiat, larcin et autres cas par ledit du Tilh commis, résultants dudit procès :
La Cour l’a condamné et condamne à faire amende honorable au devant de l’Église du lieu d’Artigues, et icelui à genoux, en chemise, tête et pieds nus, ayant la hart au col, et tenant en ses mains une torche de cire ardente, demandant pardon à Dieu, au Roi et à la Justice, auxdits Martin Guerre et Bertrande de Rols mariés ; et ce fait sera ledit du Tilh délivré ès mains de l’Exécuteur de la haute Justice, qui lui fera faire les tours par les rues et carrefours accoutumés dudit lieu d’Artigues ; et la hart au col, l’amènera au devant de la maison dudit Martin Guerre, pour icelui, en une potence qui à ces fins y sera dressée, être pendu et étranglé, et après son corps brûlé.
Et pour certaines causes et considérations à ce mouvant la Cour, celle-ci a adjugé et adjuge les biens dudit du Tilh à la fille procréée de ses œuvres et de ladite de Rols, sous prétexte de mariage par lui faussement prétendu, supposant le nom et personne dudit Martin Guerre, et par ce moyen décevant ladite de Rols ; distraits les frais de Justice ;
et en outre a mis et met hors de procès et instance lesdits Martin Guerre et Bertrande de Rols ; ensemble ledit Pierre Guerre oncle dudit Martin ;
et a renvoyé et renvoie ledit Arnaud du Tilh audit Juge de Rieux, pour faire mettre le présent Arrêt à exécution selon sa forme et teneur.
Prononcé judiciellement le 12ème jour de Septembre 1560.
Monsieur Coras observe que la sentence du Juge de Rieux fut infirmée dans la peine qu’il avait ordonnée ; parce que la décapitation, à laquelle il avait condamné Arnaud du Tilh, est la peine des criminels nobles. Un larcin, une trahison insigne qui mériteraient une peine capitale, commis par une personne d’une extraction noble, seraient pourtant punis du supplice de la potence : mais le gibet serait plus haut et plus élevé qu’il ne l’est d’ordinaire. Monsieur Coras cite là-dessus Balde.
Arnaud du Tilh a été condamné pour avoir commis sept grands crimes : fausseté de nom, supposition de personne, adultère, rapt, sacrilège, larcin, plagiat (ce dernier crime est celui qu’on commet en retenant une personne qui est en puissance d’autrui ; on est encore coupable de ce crime, suivant le droit civil, lorsqu’on dispose d’une personne libre, en la vendant, ou l’achetant comme un esclave).
Il faut remarquer la disposition de cet Arrêt, qui adjuge les biens d’Arnaud du Tilh à la fille qu’il a eue de Bertrande de Rols, à cause de la bonne foi de la mère. Cet Arrêt est conforme à un Arrêt du 5 mars 1547, rapporté par Chopin. Voici l’espèce : Un homme marié épousa une seconde femme qui ignorait ce mariage ; l’arrêt adjugea la succession du père à leurs enfants.
« Met hors de procès et d’instance Martin Guerre et Bertrande de Rols ». Monsieur Coras nous apprend dans ces termes « que les plus grandes difficultés du procès, auxquelles la Cour travailla le plus, furent si Martin Guerre et Bertrande de Rols étaient en voie de condamnation ». Martin Guerre paraissait coupable, parce qu’en abandonnant sa femme il était la cause du désordre qui était arrivé ; mais son plus grand crime était d’avoir porté les armes contre son Prince à la bataille de saint Laurent, où il avait eu une jambe emportée d’un coup de canon. M. Coras dit que la Cour considéra qu’il y avait eu plus de légèreté que de malice dans la conduite de Martin Guerre ; que, s’il avait donné l’occasion de l’adultère qu’avait commis Bertrande de Rols, c’était une occasion éloignée ; qu’il ne pouvait par conséquent être coupable au tribunal des hommes ; qu’il n’avait pas eu un dessein formel de porter les armes contre son Prince ; qu’étant allé en Espagne, il avait été laquais du Cardinal de Burgos, et puis du frère de ce Cardinal, qui l’avait emmené en Flandres ; qu’il avait été obligé de suivre son maître à la bataille de saint Laurent, où il avait combattu malgré lui, ne pouvant pas se dérober aux yeux de son maître ; que d’ailleurs il avait, par la perte d’une jambe, expié la peine de ce crime qu’on lui imputait.
À l’égard de Bertrande de Rols, elle paraissait plus coupable que Martin Guerre. Pouvait-on comprendre qu’elle eût pu être abusée par l’imposteur, si elle n’eût pas voulu l’être, et si l’erreur n’eût pas eu pour elle des attraits ? Une femme à qui un mari s’est livré si longtemps n’en saisit-elle pas des traits distinctifs, que le plus habile imposteur ne peut jamais avoir ? Quand la nature se serait mise en frais de la ressemblance la plus parfaite, ne laisse-t-elle pas toujours, dans la copie qu’elle semble faire, des différences imperceptibles à tout le monde, à la vérité ; mais non pas à une épouse ? Ce qui prouve que l’erreur avait de grandes charmes pour elle, c’est que pendant plus de trois ans on a travaillé en vain à lui dessiller les yeux. Cependant la grande opinion qu’on avait de sa sagesse, et son excuse, soutenue de l’exemple des sœurs de Martin Guerre, et de tant de personnes abusées de la même erreur ; la ressemblance frappante de l’imposteur avec celui qu’il représentait ; les indices qu’il donnait, jusqu’à rapporter les circonstances les plus mystérieuses, les époques les plus précises des événements qui n’avaient été confiés qu’au Dieu Hymen ; la crainte qu’elle avait de se déshonorer si elle poursuivait l’imposteur, et de succomber dans l’accusation, n’étant pas certaine de son erreur ; toutes ces raisons, jointes à la règle qui veut que dans le doute l’innocence se présume, firent pencher la Cour en faveur de Bertrande de Rols.
« Et a renvoyé et renvoie ledit du Tilh audit Juge de Rieux, pour faire mettre ce présent Arrêt à exécution selon sa forme et teneur ». M. Coras remarque qu’il était convenable de renvoyer l’exécution de l’arrêt au Juge de Rieux, lequel avait tout mis en usage pour rechercher la vérité et rendre une bonne justice. Il ajoute qu’il est de la dignité des Cours souveraines de maintenir et conserver l’autorité des Juges inférieurs, et que le Bien public exige qu’elles les fassent révérer ; que les Lois le leur commandent. Je dirai que leur propre intérêt les y engage ; parce que les juges subalternes sont l’image des juges supérieurs. Une autre raison qui les oblige à renvoyer l’exécution des jugements par devant les juges inférieurs, c’est que les crimes ayant été commis.
dans le ressort de ces derniers, il est important pour le Bien public que l’exemple de la punition du crime se fasse dans le lieu où il a été commis, afin d’y imprimer la crainte de la Justice.
Les aveux d’Arnaud du Tilh
Pour mettre l’arrêt en exécution, Arnaud du Tilh fut ramené à Artigues ; il fut ouï dans la prison par le Juge de Rieux : il confessa fort au long son imposture, le 16 septembre 1560. Il avoua qu’il s’était déterminé à commettre ce crime, parce qu’étant de retour du camp de Picardie, quelques amis intimes de Martin Guerre le prirent pour lui. Il s’informa d’eux de l’état de Martin Guerre, de ce qui concernait son père, sa femme, ses sœurs, son oncle et ses autres parents ; de ce qu’il avait fait avant qu’il quittât le pays. Ces nouvelles lumières, se réunissant à celles qu’il avait acquises dans les conversations qu’il avait eues avec Martin Guerre, le mirent parfaitement en état de faire face à tous ceux qui voulurent l’éprouver. Il nia de s’être servi de charmes, d’enchantement, et d’aucune espèce de magie. Il confessa encore divers autres crimes ; et il persista dans sa confession toutes les fois qu’il fut interrogé là-dessus.
Étant au pied de la potence dressée devant la maison de Martin Guerre, il lui demanda pardon et à sa femme, il parut pénétré d’une vive douleur et d’un repentir amer et douloureux, et il implora toujours la miséricorde de Dieu par son Fils Jésus-Christ, jusqu’à ce qu’il fût exécuté : son corps ensuite fut brûlé.
-----------------
---------------